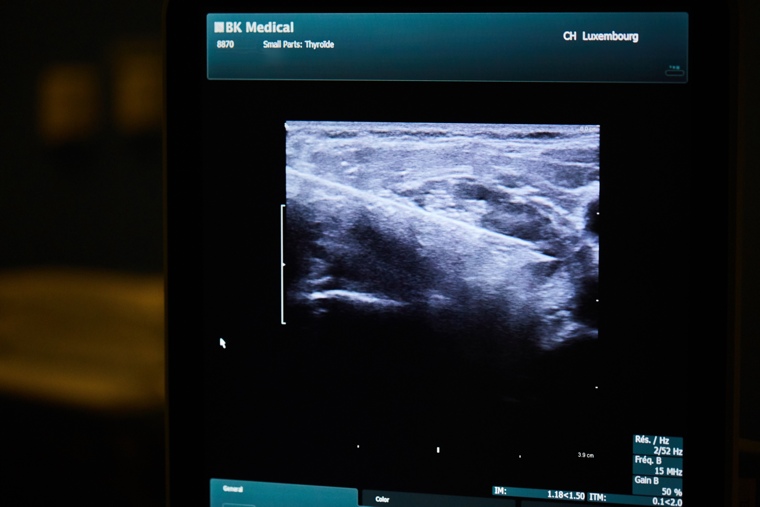Jeudi 01 février 2018, s’est tenue la 8ième édition du CHL ACADEMY en présence notamment de Mme Lydia Mutsch, ministre de la Santé, de M. Paul Mousel, président de la Commission administrative du CHL, des membres de la Direction et de nombreux collaborateurs du CHL.
Cet événement a été l’occasion de valoriser et de reconnaître l’investissement important de nos collaborateurs dans le processus d’apprentissage, de recherche et d’enseignement réalisé au cours de ces deux dernières années.
En introduction, M. Paul Mousel, Président de la Commission administrative du CHL a souligné la « longue tradition de construction des savoirs dans notre Centre Hospitalier, construction portée par notre politique de formation continue ».

Dans son discours, la Directrice des Soins Mme Monique Birkel explique: « Le CHL Academy reflète le CHL comme une organisation apprenante qui investit dans l'enseignement et la recherche pour former les futurs talents. Cela commence avec la formation des stagiaires et cela continue tout au long de la carrière des collaborateurs.»

Cette année, les travaux présentés concernent la Direction des soins. Les différents thèmes traités reflètent la palette des compétences cliniques, managériales et organisationnelles mises en oeuvre et des projets initiés dans les services. A titre d’exemple:
- La prise en charge de la douleur
- L’outil pédagogique de simulation en santé
- L’accompagnement des soins palliatifs
- Les soins et la médecine de catastrophe
- Le développement d’une clinique de la Ménopause › Le métier de coach
- La clôture de dossier
La Ministre de Santé a félicité les différents collaborateurs pour leur engagement personnel dans l’acquisition de nouvelles compétences dans un contexte d’innovation de la profession. Elle a conclu son discours en mettant en avant la richesse du métier de l’infirmière et l’importance d’intéresser les jeunes pour ce métier passionnant avant de passer à la remise des diplômes.

A la suite des discours officiels, les diplômés on pu présenter le détail et les acquis de leur formation. De nombreux et riches échanges ont permis aux intervenants d’exprimer leur motivation à se former, et leur passion du métier.
Réels aboutissements de la pensée soignante, ces travaux vont contribuer également à approfondir et à innover dans la pratique soignante, et à engager des réflexions voire des projets concrets au sein des départements et des services pour améliorer la prise en charge du patient au quotidien.